Cet été il m'est arrivé quelque chose d’extraordinaire et de presque improbable ...
Je sortais du Musée Franck Barret et marchais avec Apolline au grès des rues de Sainte-Foy-La-Grande . C'était jour de marché . Nous nous sommes arrêtées dans une librairie de livres anciens, j'ai demandé au propriétaire s'il possédait un ouvrage sur Franck Barret . Silence étonné .
J'ai d'abord cru que cet homme n'avait jamais entendu parler de l'Art Brut.
J'ai expliqué et miracle, Jean Vircoulon, puisque c'est de lui dont il s'agit a connu l'artiste, a écrit un texte sur lui . Le voici aujourd'hui pour Les Grigris, c'est un texte long mais admirable qui mérite d'être lu dans sa totalité .
Franck Barret ou le pèlerinage immobile
par Jean Vircoulon
Article publié en septembre 1994, dans Le Festin n°15
" Le jour ne pénètre que rarement dans les deux grandes pièces de cette ferme proche de Sainte-Foy-la-Grande, mais leur obscurité caverneuse abrite des trésors. Toute une création foisonnante et généreuse est tapie dans l'ombre protectrice, qui tient à la fois du bestiaire et du manuel d'histoire. Franck Barret, pendant une quinzaine d'années, a insufflé la vie à ces centaines d'êtres d'argile, grenouilles et fauves, monstres et saints. Revenant dans ce lieu chargé de mystère, un fidèle du démiurge entr'ouvre les volets sur un monde suspendu.
Une maison de vigneron, le long de la route ; très vieille, en pierres sèches. Le lierre la recouvre ; il masque les fenêtres, il déborde en gros festons sur les tuiles disjointes du toit.
La maison comprend deux pièces, la cuisine et la chambre. De leurs destinations et des vies qu'elles abritèrent, subsistent seuls le carrelage rouge, les cheminées et le badigeon ocre des murs.
On y accédait par une grange emplie de vieilleries ; à droite se trouvait le seuil de la bâtisse, surélevé, un niveau ancien dont la raison est enfouie dans des mémoires qui ne sont plus. Au-delà, c'est le «Musée Barret».
Le peu de lumière donné par les fenêtres que le lierre occulte accroche une foule de créatures en terre sèche, dans l'attente du souffle des visiteurs. Sur cette incertaine création en chambre, Franck Barret allumait deux ou trois ampoules nues ; puis il parlait de son œuvre. D'entrée, on était saisi. Le Musée semblait indéfinissable : il sautait aux yeux, et l'on n'arrivait pas à l'englober dans une pensée construite. Tout se passait comme si les certitudes intellectuelles, les critères établis, on les avait laissés au-dehors, devant l'entrée de la ferme, à deux pas de la niche du chien et de quelques toupines mises à sécher, le cul en l'air, sur des piquets.
S'instaurait un vide du cœur et de l'esprit où Franck versait un discours, celui de son Œuvre.
Il lui donnait la forme la plus ample possible, avec des mots simples et beaux comme un tourillon d'argile humide lové dans sa main, et dont il aurait fait, en un instant, une belette ou une grenouille. Il vous le donnait, comme d'un enfantelet repu d'affection et qui vient trouver le sommeil dans vos bras...
Pourtant, ce discours de la création s'ouvrait sur la mort. Franck prétendait que lorsqu'il mourrait, ses créatures redeviendraient poussière : il avait fait œuvre de démiurge et il le savait. «Ce n'est pas la peine de filmer mon Musée, avait-il affirmé aux techniciens d'une télévision allemande, je sais pertinemment que rien n'impressionnera la pellicule.» Plus tard, il ne manquait pas de préciser : «C'est bien ce qui est arrivé.»
Franck est mort. Depuis, les créatures de ses songes restituent parfois l'écho de son verbe, né du calme apparent d'une conscience pure mais tourmentée, posée comme un rai de lumière sur les formes d'argile, vierge ou renard, ange ou dragon.
Récemment, je suis revenu visiter ce musée que la mort de son guide inspiré avait rendu au silence de la vie. J'ai cherché le regard d'argile des saints, des héros et des mille bestioles, jusqu'à comprendre que tous se jouaient de ma curiosité. J'ai passé la main sur la face du petit singe ; c'était une caresse affectueuse. J'ai recueilli un peu de poussière...
Nouvelle visite. Un pèlerinage vers mon enfance, images grises des films en 8 mm que tournait mon père. Cependant, le soleil s'impose, par plaques de lumière ; impression de pérennité, d'identité entre la projection d'un vieux film qui saute, mes souvenirs, et cette lumière qui maintenant enrobe la vallée, et perce les grands arbres aux alentours de la ferme. Ce paysage familier, je le revois sous les couleurs, que l'on disait rieuses, d'une carte postale chromo des années cinquante... Et le Musée, mystérieux, inattendu, invraisemblable pour nos yeux d'enfants ! «Oh, pensions-nous du modeleur, il a les mêmes jeux que nous en plus... en plus...» Mais ce plus nous échappait, et nous nous élancions à petits pas vers des conquêtes de gosses. Franck nous plaçait devant le groupe des grandes personnes : «Les petits, mettez-vous devant, vous y verrez mieux, et, ajoutait-il avec des airs entendus destinés aux parents, il ne faut rien toucher.» Nos mères s'empressaient de nous fourrer dans le cercle des adultes.
Nous buvions des yeux les créatures en tons de rouges, bleus, verts ; l'argent, comme une cuirasse de beauté, donnait aux formes simples le clinquant d'une parade foraine. Nous allions de surprise en étonnement : le système pileux des grands préhistoriques était de la barbe de maïs ou de palmier ; les frissons de l'aigle et les vibrations de l'air s'équilibraient, immobiles, dans le fin voile d'argile de ses ailes. Grenouilles vertes ou rouges, souris des champs, écureuil à l'argile bien lustrée, eux nous fascinaient, tellement plus que le monstre du Loch Ness. L'un de nous disait : «Oh, t'as vu...» et nul n'osait plus parler : le silence avait l'immensité de ce que nous ne savions pas exprimer... «Les petits insectes, je les fais avec de la croûte de fromage hollandais, disait Franck. Et pour les poils du grand singe, on a mangé des artichauts pendant quinze jours.» Par-dessus nos têtes, il s'adressait aux parents. Notre présence, au premier rang, sur un fond d'innocence insigne, sanctifiait les retrouvailles du guide inspiré et de son extraordinaire création.
Franck racontait.
La visite cheminait ainsi en mélangeant aux êtres d'argile des êtres de chair. On parlait du bout des lèvres et les conversations faisaient un vrai murmure. Franck poursuivait un discours qui devait exprimer sa philosophie de la vie, et qui me passait par-dessus la tête : un joli concerto pour créateur soliste.
Franck recevait un public de petites gens, venus en famille, parfois de fort loin ; une sorte de miroir magique des dimanches, aux reflets changeants, qui n'exprimait aucun critère de beauté, mais des coups de cœur. Épris de sensationnel, les petites gens méconnaissaient l'artiste et se contentaient d'une rencontre avec le visionnaire, le médium, le guérisseur. Le Musée concentrait tous ces pouvoirs, comme l'aurait fait le plus précieux des talismans. Parfois, avec un éclat particulier, s'arrêtait un visiteur hors du commun, prêtre, philosophe, journaliste ou critique d'art. Par ces contacts, Franck développa une expression verbale et charnelle de sa vision du monde, qui s'est enrichie au fil des visites, et que sa mort a fini d'éparpiller sur les créatures du Musée, ramassé sur lui-même, dans la maison fermée au soleil...
Un jour, ce devait être en 1960, Franck fixa sur le linteau de la grange l'enseigne que Lagardère, le peintre, avait réalisée : «Musée de Modelage.»
Ce fut sa grande époque.
Je n'étais pas revenu depuis sa mort. Je franchis le seuil. J'évite d'allumer ; l'ombre immobile borde les figurines d'argile. Ce sont des silhouettes, non pas des personnages, des ombres d'âmes, non des caractères... Pourtant, je me laisse gagner par leur calme presque étourdissant. Ce charme profond, je le romprai lorsque j'aurai savouré jusqu'aux limites du silence les arcanes de ce monde fossile.
Franck venait du jardin ou sortait du chai, l'allure nonchalante, la démarche un peu lourde d'un chat repu et satisfait. Il regardait ; sourire aux lèvres, il secouait les cendres de sa cigarette éteinte, et s'approchait. Il relevait son béret : «Bonjour, alors...» et la conversation s'engageait. Je ne lui ai jamais parlé d'agriculture, bien que ce fut son métier. Il travaillait un lopin de terre, il avait des vignes et du maïs dont il recueillait la barbe pour confectionner le poil de ses créatures. Non, nous parlions de ce qu'il connaissait, c'est-à-dire qu'il parlait et que j'écoutais. J'entends encore sa voix, j'ai gardé le souvenir d'un débit un peu traînant, d'une sonorité grasse, plutôt grave et chantante, rythmée par un accent qui infléchissait sa parole au gré de ses certitudes et de ses vérités, c'est-à-dire sans cesse.
Franck Barret ? Un méditatif, un homme plein des caprices et des tourments du monde. Il était une plage sereine où son œuvre se dressait comme autant de rochers d'argile. Je ne crois pas qu'il ait cherché à fuir sa condition : c'était un paysan heureux, d'autant plus heureux qu'il savait, de ses mains, exprimer ses désirs, voire son désir, sa foi et ses inquiétudes, dans l'ultime caresse du geste amoureux, dévolue au bloc d'argile humide...
Voici son œuvre, nue comme le roi du conte.
Pourtant, les habits dont il nous demandait de vêtir ses créatures étaient beaux parce qu'ils présentaient les couleurs de nos propres certitudes de nos propres inquiétudes.
Son œuvre, on ne pouvait lui échapper : «Tu vois disait-il, le Yéti, je l'ai mis en face de l'entrée. C'est exprès : tu pourras te placer où tu veux devant lui, il ne te quittera pas des yeux.»
Je repense à cette affirmation, je toise le monstre, et son regard lointain continue de me fuir... À l'évidence, lui a toujours ignoré le visiteur...
Je tire le loquet, j'ouvre la vieille porte. J'admire les allées bien tracées, minuscule labyrinthe, facile, trop facile, désorientant de facilité, et trop naïf pour ne pas fasciner, chemin à peine suffisant pour que deux personnes s'y croisent, bordé par un alignement de petites pierres blanches, et rouge du rouge des vieux carreaux soigneusement balayés.
J'entre.
Nos parents nous empêchaient de sortir de ces sentiers tracés : il n'était pas question de ce précipiter dans ce monde de rêve autrement que par le rêve. «La nuit, disait Franck, je suis en train de dormir. Je sens qu'il faut que je travaille. Je me lève, je vais au Musée, et je travaille. Je prends une boule d'argile, je la travaille, elle vient de plus en plus grosse, et quand je sens qu'elle a la taille suffisante, j'en fais la tête. Quand la tête est venue, le reste arrive tout seul... je ne sais pas ce que je fais, je suis comme endormi... je reviens me coucher. Le lendemain, je vais voir ce que j'ai fait.» Il parlait de son travail : «Minuit est une heure grave. Il peut se passer des choses.» Il rallumait sa gitane maïs ; une flamme volute bleutée. La saveur d'un silence lourd de sens... Il poursuivait : «Après minuit, je vais travailler ; je m'y tiens entre deux heures et cinq heures du matin... Enfin, ça dépend. Une fois, je n'avais plus d'argile. Je suis allé en chercher aux Caches, avec ma brouette, la pelle et la pioche. Ma femme était folle d'inquiétude. Je ne sais pas comment j'y suis arrivé, je ne me rappelle de rien. Cette nuit-là, j'ai commencé le Yéti.»
Cette histoire, combien de fois l'aura-t-il racontée ? Elle disait ses efforts, sa fougue, sa passion : un jour, n'avait-il pas extrait l'argile à mains nues, comme s'il avait voulu l'arracher à l'immobile d'une grotte où elle reposait depuis des millénaires ? Une fois, Alice, sa femme, l'avait accompagné. À gravir les pentes raides, on prend la suée froide. On s'emmitoufle dans sa veste, et l'on s'enfonce dans l'ombre humide de sous-bois. On souffle comme une vieille forge jusqu'aux abords de la grotte. En sorte que le plus restreint des gamins arriverait là-haut avec l'estomac comme une corbeille vide. La grotte s'ouvre à flanc de falaise. Franck s'était encordé. Alice avait eu peur : èJe ne veux plus venir avec toi», lui avait-elle dit. Franck se fit accompagner, de temps à autre, par son neveu.
Les Caches étaient alors auréolées de mystère : n'accueillaient-elles pas les rendez-vous amoureux et les réunions louches des mauvais garçons ? On le disait, et il était si simple de le croire. Pour rien au monde, les braves gens n'auraient franchi ce voile de fumée sulfureuse qui, à leur sens, barrait l'entrée de la grotte. Dans l'argile que Franck rapportait subsistaient les radicelles d'une peur vive, profonde et lointaine comme la nuit des temps.
Alice Barret évoquait les multiples expéditions entreprises pour rapporter l'argile. Elle en frémissait encore : «Une nuit, il s'est levé, et il est parti chercher de l'argile ; oh, je dis, j'avais peur, on peut l'étrangler, là-bas, que personne ne le saurait. Je lui ai dit, tu pourras y aller quand tu veux, mais pas la nuit.» À côté de son mari, elle secouait la tête dans un geste de tendre dénégation, émue, partagée entre la joie et le frisson de l'inquiétude.
C'était sur le pas de la porte, en attendant qu'une fournée de visiteurs laisse place à la fournée suivante. On entrait. On se bousculait à pas feutrés, on chuchotait. On s'avançait dans les chemins du Musée, ligne de vie dont les efflorescences aboutissaient à des impasses gardées par des chefs-d'œuvre. À droite s'ouvrait une première impasse. Franck s'y tenait, près d'une cuisinière enveloppée d'émail marron, qui occupait la place du foyer. C'était son bureau.
Là, il préparait les colombins d'argile, il façonnait les petits modelages et il les peignait. La cuisinière-bureau porte encore quelques lettres, des coupures de presse, deux ou trois pots de peinture, un pot de colle, des crayons, des pinceaux et un ancien catalogue de la Manufacture d'Armes et Cycles de Saint-Etienne. Ficelé au tuyau, un squelette de nid abrite un squelette de corbeau. Dans un angle repose une perruche verte, grandes orbites vides, sèche, déplumée.
Un jour, par mégarde, je l'ai faite tomber. «Il faut que tu ailles la chercher toi, et que tu la remettes exactement où elle était. C'est pas parce que j'y crois, mais il faut la remettre exactement à la même place, on ne sait jamais.» Sa voix était un petit ruisseau de voix, il était gêné.
J'ai pensé que l'équilibre de son univers le dépassait. «Tu sais…» commençait-il, et le discours se dirigeait vers des horizons d'où Franck serait un jour absent...
À petit pas, je continue de m'avancer dans ce qui fut sa ligne de vie. Je regarde les créatures immobiles, je retrouve les échos de nos conversations d'hier.. «Tu sais», disait-il... je revois son visage placide, sa bonhommie ; je sais la certitude avec laquelle il décrivait ses personnages, je sais leur beauté naturelle, je la constate, et elle m'émerveille.
Un après-midi, j'ai suivi la course du soleil trop rare sur les paysages du Musée, avec l'infinie tristesse d'utiliser de grands mots pour exprimer des émotions profondes et simples. J'ai regardé ce Charles VI devenant fou en Pan 1392, sa première œuvre, naïve et presque fanfaronne, posée sur la cheminée de ce qui fut une chambre, j'ai regardé l'homme préhistorique, trop sec, et dont le thorax s'affaisse : le temps a ridé les créatures de rêve. Je chantonne le premier air qui me vienne en tête : «J'ai descendu dans mon jardin, pour y cueillir du romarin.» Et la suite se perd dans les abysses du Musée, ou règne le silence, et dont je n'ai pas conscience.
Franck se piquait de préhistoire. À l'entendre, un même mystère enveloppait sa propre création et celle du monde. Cette vérité première, il l'énonçait sans malice ni prétention, et le cours magistral qu'il délivrait, car c'était magistral, n'avait jamais autant de saveur que lorsqu'il lui donnait pour cadre ce coin de jardin qui vient toucher le poulailler.
Franck Barret n'expliquait rien, il se contentait de raconter. Tout avait commencé, comme une adresse à son fils premier-né, par l'envie de chanter un hymne à la vie. Franck s'est allongé un instant sur les talus du monde, le temps de fondre les rythmes saisonniers du travail dans le plaisir pulpeux des jeux. «L'instant, disait-il, avait duré mille et une nuits...»
Il avait alors recréé le site de Lourdes : collines, vallons, grotte et basilique, foules d'argiles peintes en couleurs vives, encombrant les sentiers et les prés, débordant sur le parvis du monument. Bonhommes de terre que tord la douleur, vous accompagnez la Passion d'un Christ d'argile, et vos attitudes de terre figée expriment la ferveur exaltée de votre créateur. Franck n'était jamais allé à Lourdes. Il n'avait utilisé ni photographies, ni plans. Il affirmait s'être promené en rêve autour de la grotte, et l'avoir alors découverte avec la minutie et la précision dont témoignait le panorama. Fallait-il mettre en doute sa parole, au risque de refermer les trouées oniriques et subtiles qu'il avait ouvertes sur ces paysages fouillées ?
Funiculaire, maisons, avions, voitures, attelages, personnages multiples… la vie coule autour de la basilique comme la glaise avait giclé des mains de l'artiste.
Les questions techniques sur lesquelles butait le visiteur, il les balayait d'un revers de la main et son discours aurait pu se résumer ainsi : «J'ai rêvé, j'ai fait.»
Ce paysage miniature, éclairé par de petites lumières, donnait au visiteur l'envie de parler, de décrire, de prendre les mots comme les guides les plus sûrs pour suivre les minuscules foules bariolées sur le chemin de la Passion, en même temps, il réclamait un de ces longs silences où se clôt la difficulté d'être dans un monde si évident mais tellement lointain. Un visiteur avait chuchoté ce mot ingénuement extasié : «Oh, il a vu grand...»
Il n'existait pas de photographies montrant la maturation de l'œuvre, pas de brouillon, pas d'essais ratés. Tout était accompli, avec la force que seule une perspective «fataliste» peut donner à ce mot : l'œuvre sublime n'était qu'un songe exprimé dans les limites étroites de ces deux pièces au plafond bas. Pour les visiteurs qui arrivaient par cars entiers, dimanche après dimanche, Franck devenait un guide indispensable, de ceux qui connaissent si bien leur terroir pour l'avoir parcouru en tous sens que l'on finit par croire qu'ils sont apparus avec lui.
Il lui arrivait de refuser des cars, de peur que son petit Musée ne suffoque sous l'afflux des visiteurs. «Soyez gentils, pas plus de six ou sept personnes à la fois», demandait-il aux touristes, du pas de la porte. On s'agglutinait avec soin dans ces deux pièces achevées, qu'il était impossible d'imaginer en cours de remplissage ; et l'on ressortait persuadé qu'un mystérieux phénomène de génération spontanée leur avait donné cette stupéfiante plénitude.
Les dates d'apparition des grands personnages, il les avait inscrites sur l'épaule ou en haut de la poitrine, à côté de ses initiales : «F.B.», calligraphiées en majuscules anglaises. Il avait tout fait en une quinzaine d'années, de 1949 à 1964.
J'ai inventorié les créatures. C'était le début d'un «repérage» du Musée ; j'ai caressé l'idée de le cartographier, de lui apporter une sorte de carroyage intellectuel. Morceler son espace, frag- menter ses rythmes en éléments satisfaisants.
Vertigineux programme ! Un temps, j'étais parti pour le jauger ; j'en scrutais les moindres détails avec une admiration faussement naïve, jusqu'à rire des résultats possibles qu'amènerait une pareille démarche : à la limite, le rapport d'une quantité sinon d'une qualité d'émotion dégagée, par kilogramme d'argile pétrie ! Une sorte de calorie-étalon du cœur, dont l'unité, en argile irradiée, serait déposée dans je ne sais quel pavillon de Breteuil.
Le Musée nié, l'argile rendue en terre, l'œuvre se résolvant à l'épopée de son seul créateur... Cette idée m'était venue après la mort de Franck. Elle était restée diffuse, à peine consciente. Un temps, elle m'a aidé, en l'absence du guide, à meubler mes visites.
En vain, j'ai joué les iconoclastes, et je m'en réjouis : avec l'échec de cette tentative d'épuisement de l'Œuvre par une approche intellectuelle ont disparu, à mon sens, les qualificatifs de «morbide» et d'«hallucinant» dont on avait si souvent gratifié le Musée.
L'Œuvre regorge de tendresse et de naïveté : un beau jour, Franck est parti à la découverte du monde avec la foi d'un enfant qui, ayant ramassé sur la plage un joli coquillage abandonné par les flots, se prend à rêver des merveilles que l'océan recèle ; et ce jour n'a pris fin qu'avec sa mort. Christ de paix, hiératique, rameau d'olivier en main. Martien aux yeux bridés dont le pistolet fulgurant perd sa puissance à trop ressembler à un sèche-cheveux. Pithécanthrope attentif à une ligne d'horizon qui me dépasse : les trois premiers grands person- nages, datés des années 1952 et 1953, marquent une cosmogonie qui vous prend comme cette odeur fraîche de vie que la terre dégage après une averse. L'argent ruisselle, tunique argentée du Christ, Martien en combinaison noire cerclée d'argent. Le Pithécanthrope est nu, glabre, couleur d'argile... Fascinant voisinage.
Ces trois personnages, j'aurais voulu les charger de symboles, savourer leurs couleurs comme une gourmandise, imaginer, rêver, danser pour eux une danse du cœur et de l'esprit ; j'aurais voulu pallier les silences de Franck. «Tu sais...» disait-il, alors, j'écoutais... Les fenêtres barricadées filtrent les bruits lointains de la campagne. Elles sont à l'épreuve des flots de lumière. Je suis entré, j'ai refermé la porte du Musée, j'ai allumé les loupiottes. Je suis bien, l'arche est calfeutrée pour un voyage qui me lais- sera un jour échoué sur je ne sais quelle plage.
Je ne vois plus les murs trop proches ; le regard se perd sous les feuillages, occupé à distinguer la fleur en plastique de la branche de genévrier. J'aime ce fouillis végétal, reposoir de songes légers, au creux d'une après-midi privilégiée... Les bestioles se succèdent, hôtes étranges, repères fallacieux fixés dans un labyrinthe démesuré : ce réduit, deux pièces, s'ouvre sur les espaces infinis de la vie. Tout est en trompe-I'œil ; rien n'est ce qu'il prétend être. Jusqu'aux noms qui désignent quelques animaux d'argile : ils sont trop savants et trop hiéroglyphiques pour se laisser comprendre par le visiteur, alors que le modeleur, lui, a su dégager de l'argile douce les animaux de son arche. Tout se dérobe et s'ameute à l'abri de la rangée des petits cailloux blancs qui bordent les chemins.
J'ignore les principes qui ont présidé au remplissage du Musée. Quelques tableaux didactiques évoquent le règne animal: sur le mur nord, des insectes, puis des poissons. D'autres panneaux apportent un témoignage fragmentaire sur les temps géologiques. Rien n'est achevé ; à l'évidence, les tableaux ne peuvent être ni complets, ni systématiques. L'échelle est diverse, et si l'on veut n'en trouver qu'une, ce sera celle d'un regard complice, voire amical, celui du visiteur qui aura bien voulu accepter cette création offerte, le temps d'un passage. Alors, pourquoi l'éléphant n'aurait-il pas la taille d'une souris, pourquoi le crapaud ne dominerait-il pas le tigre ?
Les animaux de nos campagnes ont la part belle et leur taille naturelle : petits rongeurs, grenouilles, cingles, lézards, renards... Il y a peu d'oiseaux, mais ils sont admirables. Peut-être leur confection présentait-elle de sérieux problèmes techniques, et puis, comment les confier à leur élément, l'air, l'espace, comment les suspendre sur un souffle immatériel, et que le système soit suffisamment ingénieux pour échapper au regard, et solide, pour défier le temps ?
Le bestiaire mural évoque ces tableaux de lecture utilisés autrefois dans les écoles, ou bien les planches coloriées du Dictionnaire Larousse en deux volumes : ce sont des miroirs où l'appétit de savoir d'un enfant, immense, s'irise aux couleurs de son imagination.
Bien sûr, ces sources possibles des thèmes animaliers de Franck Barret, je les postule ; les pièces aux murs badigeonnés, les voici agencées en classe de rêve, dans la torpeur d'un matin d'hiver, toutes ouvertures closes, et le poêle ronflant sourdement.
J'imagine encore le silence ouaté, celui auquel la neige donne des résonances sèches et fraîches, pour mieux saisir la démarche quasi-initiatique de gamins, qui, allant à l'école, s'isolent momentanément du monde pour mieux apprendre à le connaître.
Pourtant, Franck n'a pas quitté les rives de sa Dordogne natale, et son grand voyage, assister à l'incessant changement des couleurs du jour sur l'horizon des collines proches, il l'a relaté dans SON Musée, avec un réalisme parfois douloureux, mais toujours empreint de tendresse.
Monde clos, œuf, arche, terre promise enfin obtenue... II m'arrivait de considérer les petits paysages du Musée comme les îles d'un archipel où seul le modeleur pouvait prendre pied.
Peu d'oiseaux. Mais l'aigle éclate de beauté, car il porte le défi du modeleur à son bloc d'argile.
... J'ai tenté de surprendre leur dialogue, mots chuchotés, échos affaiblis dans l'espace clos des deux pièces, comme une source venue sourdre du sol pour se perdre sous les fougères arborescentes d'un vallon...
Il y avait cette passion que Franck vouait aux chromes rutilants des motos et des voitures anciennes. Il possédait entre autres un cabriolet biplace, bas de caisse, époustouflant, rapide au possible, et sport en diable, dont il ne tirait jamais que le strict minimum. Un pas de sénateur lui suffisait, parce que c'était l'allure d'un paysan se rendant au marché de Sainte-Foy, ou gagnant sa vigne ; c'était l'allure «convenable». Sous la petite table supportant le panorama du vieux château de Pineuilh, Franck avait fourré deux cageots emplis de lettres que lui avaient envoyées les personnes en manque d'affection, de santé ou d'argent, de ces lettres qu'un guérisseur reçoit ; messages à destination d'une terre promise qu'il avait su peupler d'êtres épanouis, respirant enfin d'un souffle pur, et dont la douleur et la fragilité se résorbaient à fleur d'argile, dans leur écorce clinquante de couleurs vives.
Longtemps, j'ignorais sa joie de vivre. Les certitudes admirables dont il émaillait sa conversation comme on écosse des petits pois, ce n'est qu'après sa mort que j'ai su qu'elles exprimaient... qu'importe, elles étaient vraies, simples, discrètes, un parfum de vie, un reflet, un écho, tout ce qui fleurera bon Pair du temps, et presqu'inutiles, pour qui sait se contenter d'être...
Quant au Musée, il «était», il imposait non seulement sa présence, mais le respect, la précaution, «Attention, disait Franck, c'est fragile», et puis la crainte, «regardez, disait-il, c'est d'une force...» Un langage de terre douce, vocabulaire, syntaxe, magie de la distorsion, du voyage même accompli par la terre, de la profondeur des Caches à celle de nos âmes, et tous les qualificatifs qui rendront le Musée vrai, simple et discret, en un mot, présentable. Mes parents disaient : «Cet après-midi, nous irons voirie Musée de modelage», et nul n'en parlait, parce que voir était tellement plus merveilleux ! Alors, le Musée, je sais maintenant qu'il était l'une des certitudes admirables de Franck, une preuve, ma foi, presqu'inutile.
Lorsque j'ai commencé d'écrire ce texte, je suis venu souvent démêler ici l'écheveau de mes souvenirs. La laine que j'ai cardée était faite de mots que j'accumulais à foison, avec passion, je les ai beuglés, quand ils ne m'ont pas sussuré leur propre divertissement – avant d'expurger ceux qui me paraissaient inutiles, ceux qui appellent une vision, une odeur, un mouvement, un timbre de voix, et qui restent pourtant seuls, parce que suspendus au fil d'un souvenir que le temps a distendu. Je me suis méfié du Musée, comme d'un révélateur fallacieux. Le temps d'écrire ces quelques pages, plusieurs mois ont passé.
Franck est mort. Je me suis aperçu que le Musée pouvait accueillir tout ce qui m'est arrivé ; je n'ai pas rencontré d'émotion, de sentiment ou d'état d'esprit qui lui fussent étrangers. Un Musée fourre-tout, tel que Barret l'avait voulu, rêvé et fait.
L'Œuvre était fragile, chancelante, parce qu'elle avait versé, dès sa création, dans les ornières de la vie, d'une vie...
J'admirais que jusqu'à ce que ses forces l'aient abandonné, Franck soit venu ici, chaque jour, pour retaper, rafistoler, badigeonner une couleur plus vive sur la couleur fanée. Il était devenu ce qu'il n'avait jamais cessé d'être, le seul visiteur de son Musée."
**** Cet article a été publié en septembre 1994, dans Le Festin n°15
Archive : Franche Création
*** Les photographies (sauf la première qui m'a été donnée par Jean Vircoulon) sont de Jean-Christophe Garcia
Souvenir de l'été 2011 ....































.jpg)



































































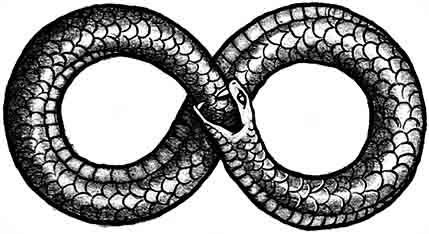





















































Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire