"La plus grande œuvre d'art jamais créée dort dans les cartons d'un appartement miteux. Ethan Muller, un galeriste new-yorkais, décide aussitôt d'exposer ces étranges tableaux, qui mêlent à un décor torturé, d'innocents visages d'enfants. Le succès est immédiat, le monde crie au génie. Mais un policier à la retraite croit reconnaître certains visages : ceux d'enfants victimes de meurtres irrésolus…"
" « - Où sont les œuvres ? » demandai-je.
Tony se faufila jusqu’à moi.
« Là », dit-il en posant la main sur le carton le plus proche.
Puis il me désigna tous les autres cartons :
« Et là, là et là. »
Incrédule, j’en ouvris un au hasard. A l’intérieur se trouvait une pile bien rangée de ce qui m’apparut d’abord comme des feuilles de papiers vierges, jaunies et écornées. L’espace d’un instant, je crus que Tony se moquait de moi. Puis je ramassai la première page, la retournai, et alors tout le reste s’évanouit.
Les mots me manquent pour vous décrire ce que je vis. J’essaie quand même : une ménagerie étourdissante de formes et de visages ; des anges, des lapins, des poulets, des lutins, des papillons, des bêtes informes, des créatures mythologiques à dix têtes, des machines extravagantes avec des bout d’organes humains, le tout tracé d’une main précise, minutieux et grouillant sur la feuille, vibrant de mouvement, dansant, courant, jaillissant, dévorant, se dévorant mutuellement, perpétrant des tortures atroces et sanglantes, un carnaval de luxure et d’émotions, toute la sauvagerie et la beauté que la vie peut offrir, mais en exagéré, délirant, intense, puéril, pervers, avec un coté BD joyeux et hystérique ; et, moi, je me sentis assailli, agressé, pris d’un furieux désire à la fois de détourner le regard et de plonger dans la page.
Cependant, le plus grand soin du détail se concentrait non pas sur ces personnages mais sur le décor qu’ils peuplaient. Une terre vivante, aux dimensions variables : une géographie tantôt plate, tantôt formidablement déchiquetée et exubérante, traversée de routes sinueuses portant des noms de vingt lettres. Les montagnes étaient des fesses, des seins et des mentons ; les fleuves se transformaient en veines charriant un liquide violacé qui nourrissait des fleurs à tête de diable ; des arbres surgissaient d’un paillis de mots réels ou inventés et d’herbes en lames de rasoir. A certains endroits, le trait était léger comme un murmure, ailleurs si noir et épais que c’était un miracle que le crayon n’ait pas transpercé le papier.
Le dessin semblait repousser les bords de la feuille et s’épancher dans l’air trouble de la pièce.
Electrisé, décontenancé, je l’examinai pendant six à sept minutes, ce qui est long pour une feuille A4. Et, avant de pouvoir me censurer, je décidai que l’auteur de ce dessin était forcément fou. Parce que la composition avait un aspect psychotique, une sorte de fièvre hyperactive destinée à se réchauffer contre le froid glacial de la solitude.
Je tentai de replacer ce que j’avais sous les yeux dans le contexte d’autres artistes. Les seules références qui me vinrent à l’esprit sur le moment furent Robert Crumb et Jeff Koons. Mais ce dessin n’avait rien de leur kitsch et de leur ironie ; il était brut, honnête, naïf et violent. Malgré mes efforts pour le faire entrer dans un moule, pour l’apprivoiser au moyen de ma rationalité, de mon expérience et de mon savoir, j’avais pourtant l’impression qu’il allait bondir de mes mains, ricocher sur les murs et se consumer en fumée, en cendres, en oubli. Il était vivant.
« Qu’est-ce que tu en penses ? » me demanda Tony.
Je ramassai la feuille suivante. Elle était tout aussi baroque, tout aussi hypnotisante, et je lui consacrai la même attention. Puis, prenant conscience que si je m’attardais autant sur chaque dessin je n’en finirais jamais, j’en empoignai une pile et les feuilletai rapidement, réduisant en poussière une fine bande de papier le long de leur bord. Ils étaient tous époustouflants. Tous sans exception. Mon estomac se noua. L’absolue monomanie du projet me paraissait déjà dépasser l’entendement.
Je reposai la pile et réexaminai les deux premiers dessins, que je plaçai côte à côte pour les comparer. Mes yeux ne cessaient de passer de l’un à l’autre, comme ces jeux qu’on fait quand on est enfant : il y a 9 000 différences, sauras-tu les repérer ? Je commençai à avoir le tournis. Peut-être à cause de la poussière.
« Tu as compris comment ça marchait ? » me demanda Tony.
Je n’avais pas compris, aussi retourna-t-il une des feuilles. Les dessins se suivaient telles les pièces d’un puzzle : les rivières et les routes circulaient d’une page à l’autre, des demi-visages retrouvaient leur moitié manquante. Tony me fit remarquer que le verso n’était pas blanc, comme je l’avais d’abord cru : sur chaque bord et au centre, à peine esquissés au crayon d’une écriture uniforme et minuscule, figuraient des numéros. (…)
La feuille suivante portait le numéro 4379 au centre puis, à partir du haut dans le sens des aiguilles d’une montre : 2017, 4380, 6741, 4378. Les pages se raccordaient là où le bord de l’une indiquait le centre de l’autre.
« Ils sont tous comme ça ?
-J’en ai bien l’impression, dit Tony en balayant la pièce du regard. Mais je n’en ai vu qu’une infime portion.
- Il y en a combien, à ton avis ?
- Approche. Viens voir par toi-même. »
(…)
La lumière venant du palier baissait et ma propre respiration semblait n’avoir plus aucun écho. Les 2,50 mètres entre la porte et moi avaient purement et simplement effacé New-York. Habiter là, c’était comme habiter 15 kilomètres sous terre. Ou dans une grotte. Je ne vois pas de meilleure façon de le décrire. C’était effroyablement déroutant.
De très loin, j’entendis Tony prononcé mon nom.
Je m’assis sur le bord du lit – à peine 15 centimètres de matelas étaient dégagés ; où donc dormait-il ? - et inspirait une grande lampée d’air poudreux. Combien de dessins pouvait-il avoir ? A quoi devait ressembler l’ensemble une fois reconstitué ? Je m’imaginai un interminable édredon en patchwork. Ce n’était pas possible qu’ils se raccordent tous. Ce n’était pas possible que quelqu’un ait autant de patience ni de puissance mentale. Si Tony avait vu juste, j’avais devant moi l’une des plus vaste œuvres d’art jamais produites par un seul individu. En tout cas, c’était certainement le plus grand dessin du monde.
La pulsation du génie, les remugles de la folie ; sublimes et vertigineux ; j’en avais le souffle coupé.
Tony se faufila entre deux cartons pour venir me rejoindre. Nous suffoquions tous les deux.
« Combien de gens sont au courant ? demandai-je.
-Toi. Moi. Le syndic. Peut-être deux ou trois autres personnes à l’agence, mais elles n’ont fait que transmettre le message. Il y a très peu de gens qui l’ont vu devant leurs yeux.
-Il veut mieux que ça reste entre nous. »
Il acquiesça d’un hochement de tête. Puis il dit :
« Tu n’as pas répondu à ma question.
- Quelle question ?
- Qu’est-ce que tu en penses ? »
Tony se faufila jusqu’à moi.
« Là », dit-il en posant la main sur le carton le plus proche.
Puis il me désigna tous les autres cartons :
« Et là, là et là. »
Incrédule, j’en ouvris un au hasard. A l’intérieur se trouvait une pile bien rangée de ce qui m’apparut d’abord comme des feuilles de papiers vierges, jaunies et écornées. L’espace d’un instant, je crus que Tony se moquait de moi. Puis je ramassai la première page, la retournai, et alors tout le reste s’évanouit.
Les mots me manquent pour vous décrire ce que je vis. J’essaie quand même : une ménagerie étourdissante de formes et de visages ; des anges, des lapins, des poulets, des lutins, des papillons, des bêtes informes, des créatures mythologiques à dix têtes, des machines extravagantes avec des bout d’organes humains, le tout tracé d’une main précise, minutieux et grouillant sur la feuille, vibrant de mouvement, dansant, courant, jaillissant, dévorant, se dévorant mutuellement, perpétrant des tortures atroces et sanglantes, un carnaval de luxure et d’émotions, toute la sauvagerie et la beauté que la vie peut offrir, mais en exagéré, délirant, intense, puéril, pervers, avec un coté BD joyeux et hystérique ; et, moi, je me sentis assailli, agressé, pris d’un furieux désire à la fois de détourner le regard et de plonger dans la page.
Cependant, le plus grand soin du détail se concentrait non pas sur ces personnages mais sur le décor qu’ils peuplaient. Une terre vivante, aux dimensions variables : une géographie tantôt plate, tantôt formidablement déchiquetée et exubérante, traversée de routes sinueuses portant des noms de vingt lettres. Les montagnes étaient des fesses, des seins et des mentons ; les fleuves se transformaient en veines charriant un liquide violacé qui nourrissait des fleurs à tête de diable ; des arbres surgissaient d’un paillis de mots réels ou inventés et d’herbes en lames de rasoir. A certains endroits, le trait était léger comme un murmure, ailleurs si noir et épais que c’était un miracle que le crayon n’ait pas transpercé le papier.
Le dessin semblait repousser les bords de la feuille et s’épancher dans l’air trouble de la pièce.
Electrisé, décontenancé, je l’examinai pendant six à sept minutes, ce qui est long pour une feuille A4. Et, avant de pouvoir me censurer, je décidai que l’auteur de ce dessin était forcément fou. Parce que la composition avait un aspect psychotique, une sorte de fièvre hyperactive destinée à se réchauffer contre le froid glacial de la solitude.
Je tentai de replacer ce que j’avais sous les yeux dans le contexte d’autres artistes. Les seules références qui me vinrent à l’esprit sur le moment furent Robert Crumb et Jeff Koons. Mais ce dessin n’avait rien de leur kitsch et de leur ironie ; il était brut, honnête, naïf et violent. Malgré mes efforts pour le faire entrer dans un moule, pour l’apprivoiser au moyen de ma rationalité, de mon expérience et de mon savoir, j’avais pourtant l’impression qu’il allait bondir de mes mains, ricocher sur les murs et se consumer en fumée, en cendres, en oubli. Il était vivant.
« Qu’est-ce que tu en penses ? » me demanda Tony.
Je ramassai la feuille suivante. Elle était tout aussi baroque, tout aussi hypnotisante, et je lui consacrai la même attention. Puis, prenant conscience que si je m’attardais autant sur chaque dessin je n’en finirais jamais, j’en empoignai une pile et les feuilletai rapidement, réduisant en poussière une fine bande de papier le long de leur bord. Ils étaient tous époustouflants. Tous sans exception. Mon estomac se noua. L’absolue monomanie du projet me paraissait déjà dépasser l’entendement.
Je reposai la pile et réexaminai les deux premiers dessins, que je plaçai côte à côte pour les comparer. Mes yeux ne cessaient de passer de l’un à l’autre, comme ces jeux qu’on fait quand on est enfant : il y a 9 000 différences, sauras-tu les repérer ? Je commençai à avoir le tournis. Peut-être à cause de la poussière.
« Tu as compris comment ça marchait ? » me demanda Tony.
Je n’avais pas compris, aussi retourna-t-il une des feuilles. Les dessins se suivaient telles les pièces d’un puzzle : les rivières et les routes circulaient d’une page à l’autre, des demi-visages retrouvaient leur moitié manquante. Tony me fit remarquer que le verso n’était pas blanc, comme je l’avais d’abord cru : sur chaque bord et au centre, à peine esquissés au crayon d’une écriture uniforme et minuscule, figuraient des numéros. (…)
La feuille suivante portait le numéro 4379 au centre puis, à partir du haut dans le sens des aiguilles d’une montre : 2017, 4380, 6741, 4378. Les pages se raccordaient là où le bord de l’une indiquait le centre de l’autre.
« Ils sont tous comme ça ?
-J’en ai bien l’impression, dit Tony en balayant la pièce du regard. Mais je n’en ai vu qu’une infime portion.
- Il y en a combien, à ton avis ?
- Approche. Viens voir par toi-même. »
(…)
La lumière venant du palier baissait et ma propre respiration semblait n’avoir plus aucun écho. Les 2,50 mètres entre la porte et moi avaient purement et simplement effacé New-York. Habiter là, c’était comme habiter 15 kilomètres sous terre. Ou dans une grotte. Je ne vois pas de meilleure façon de le décrire. C’était effroyablement déroutant.
De très loin, j’entendis Tony prononcé mon nom.
Je m’assis sur le bord du lit – à peine 15 centimètres de matelas étaient dégagés ; où donc dormait-il ? - et inspirait une grande lampée d’air poudreux. Combien de dessins pouvait-il avoir ? A quoi devait ressembler l’ensemble une fois reconstitué ? Je m’imaginai un interminable édredon en patchwork. Ce n’était pas possible qu’ils se raccordent tous. Ce n’était pas possible que quelqu’un ait autant de patience ni de puissance mentale. Si Tony avait vu juste, j’avais devant moi l’une des plus vaste œuvres d’art jamais produites par un seul individu. En tout cas, c’était certainement le plus grand dessin du monde.
La pulsation du génie, les remugles de la folie ; sublimes et vertigineux ; j’en avais le souffle coupé.
Tony se faufila entre deux cartons pour venir me rejoindre. Nous suffoquions tous les deux.
« Combien de gens sont au courant ? demandai-je.
-Toi. Moi. Le syndic. Peut-être deux ou trois autres personnes à l’agence, mais elles n’ont fait que transmettre le message. Il y a très peu de gens qui l’ont vu devant leurs yeux.
-Il veut mieux que ça reste entre nous. »
Il acquiesça d’un hochement de tête. Puis il dit :
« Tu n’as pas répondu à ma question.
- Quelle question ?
- Qu’est-ce que tu en penses ? »
Pour Roger Cardinal ... avec toute mon admiration























.jpg)



































































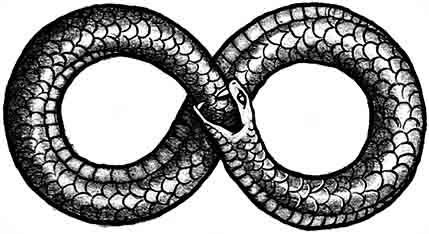





















































Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire