Le monde selon Roger Ballen vu par Martine Lusardy dans l'introduction du catalogue :
Roger Ballen règne sur
le monde noir et blanc de la psyché humaine.Troublante, provocante et
énigmatique, l’œuvre du photographe sud-africain d’origine américaine,
géologue de formation, exprime le sentiment de confusion de l’homme
confronté au non-sens de son existence et du monde même. Ballen enchaîne
depuis plus de trente ans les expositions dans les hauts lieux de la
culture. Si chacune d’entre elles est un événement, son choix d’exposer à
la Halle Saint Pierre, musée atypique consacré à l’art brut et aux
formes hors normes de la création, marque son indépendance vis-à-vis des
modes artistiques. Pour la Halle Saint Pierre la collaboration avec
Roger Ballen est une invitation à mettre à l’œuvre – ou à l’épreuve –
cette altérité artistique et culturelle que représente l’art brut.
L’artiste n’a cessé de soutenir dans son rapport à la création un art
qui s’origine dans les couches profondes de l’être humain ; il n’a cessé
de tendre, à la manière d’Antonin Artaud, vers un art d’appel à
l’origine.
C’est dans les hors-champs de la
culture, ceux de la claustration et de l’exclusion, que Jean Dubuffet
va reterritorialiser l’art, avec l’idée qu’il y est plus authentique et
singulier. Créateurs réfractaires ou imperméables aux normes et valeurs
de « l’asphyxiante culture » sont les hérauts d’un nouveau rapport au
monde dont ils défrichent les potentialités inexploitées. Pour eux la
création est une protestation de la vie devant la menace du néant. La
dimension singulière de cette expérience humaine, parce qu’elle
s’inscrit dans des objets artistiques improbables mais à même de
représenter cet appel d’être, ne peut être accueillie qu’avec sa charge
d’étrangeté et d’inquiétude. L’esprit du temps se reconnait dans cet art
extrême et il faut alors oser emprunter les chemins qui y
conduisent, réinventer les formes et le langage qui les rendent
sensibles et supportables. Penser avec l’art brut offrirait une
direction possible pour nos quêtes de vérité et de sens.
« Mes 18 ans furent l’âge où je connus
un désir existentiel profond que rien ne pouvait apaiser, ni d’avoir
grandi dans une banlieue juive ni mon éducation », écrit Ballen dans Ballenesque
(2017). « Comme beaucoup de personnes dans le milieu de la
contre-culture, je ressentais le besoin de rompre avec le matérialisme
de la société occidentale […] de poursuivre comme Conrad la quête du
« cœur des ténèbres », de chercher le nirvana à l’Est. À l’automne 1973,
presque sans prévenir, je quittai les États-Unis pour un voyage de cinq
ans qui me conduisit sur les routes du Caire à Cape Town, d’Istanbul à
la Nouvelle-Guinée. » De retour aux États-Unis en 1977, Ballen y termine
son premier livre de photographies, Boyhood (1979) – vision
personnelle du thème intemporel de l’enfance –, et obtient en 1981 son
doctorat en économie minière. L’année suivante, il s’installe en Afrique
du Sud, à Johannesburg, mais la sécurité matérielle que lui procure le
métier de géologue ne met nullement un terme à ses interrogations sur le
sens de la vie. Et c’est muni de son appareil photo qu’il se livre à
une autre activité : l’investigation d’une Afrique du Sud pauvre et
profondément rurale, une Afrique refoulée, comme métaphore d’un voyage
introspectif, identitaire et esthétique.
Lorsque Roger Ballen photographie ces
Sud-Africains marginalisés par la peur, la misère et l’isolement, il
transforme le temps de ceux-là mêmes qui vivent dans le monde du geste
répétitif et absurde en un autre temps où ils deviennent les auteurs
d’un univers plastique qu’ils ont engendré.
Dans Dorps, Small Towns of South Africa (1986),
Ballen nous montre ces petites villes d’Afrique du Sud en pleine
décadence, avec leurs architectures et leurs habitants. Attiré par
« leur gloire croulante et décolorée avec leur avant-goût de décrépitude
et leurs restes de promesses inaccomplies », il entre littéralement et
métaphoriquement dans cet univers dont il enregistre les anomalies
visuelles et culturelles comme les signes d’une culture agonisante. Puis
il dresse avec Platteland (1994) le portrait réaliste et
pitoyable du monde rural pendant l’Apartheid. Il photographie dans leur
quotidien et leur intimité les protagonistes d’un désarroi politique,
économique et racial avec leurs dégâts physiques et psychiques. Mais
plus que les événements eux-mêmes ce sont leurs manifestations comme
drames visuels qui, à ses yeux, font sens. Beaucoup de murs qu’il a
photographiés revêtent selon lui la qualité d’œuvres d’art et auraient
leur place dans un musée. Pour le photographe, il ne s’agit donc pas
seulement d’une prise de conscience mais aussi d’une prise de vision. En
effet, bien qu’habitées par une force documentaire et sociale
inévitable, ses photographies ne sont pas des images déterminées
socialement. L’acte de photographier s’impose, non comme un témoignage,
mais comme un devoir de transfiguration. Ce sont les profondeurs de
l’âme humaine que la photographie de Roger Ballen explore, là où le
monde qui a perdu le sens de l’équilibre a laissé le trouble de sa
trace.
Depuis 1995, les expérimentations
visuelles de Ballen rendent continuellement incertaines les frontières
entre réalité et fiction. Passant d’une esthétisation du réel à une
esthétisation de l’inconscient, sa photographie creuse un paysage mental
qui n’est pas sans évoquer les paysages mentaux de Dubuffet, ces
« paysages de cervelle » par lesquels le peintre visait à restituer le
monde immatériel qui habite l’esprit de l’homme. Mais c’est surtout avec le théâtre de Samuel Beckett, à qui il consacra
un film en 1972, que l’ensemble de l’œuvre de Roger Ballen entre en
résonance. Il exprime un même sentiment de confusion et d’aliénation
face à un monde incompréhensible et irrationnel où l’homme désarmé,
dépossédé, porte en lui le poids de la condition humaine. Tout comme
Beckett, Ballen rend cette réalité dans toute sa cruauté et son
absurdité.
Outland en 2001, Shadow Chamber en 2005 puis Boarding House
en 2009 marquent la mise en place lucide d’un style et d’un vocabulaire
uniques. Ballen introduit la mise en scène où il projette ce vertige
existentiel. Sous le théâtre la vérité. Les marginaux avec qui il
interagit et avec qui il a construit au fil du temps des relations
fortes de sympathie deviennent eux-mêmes les acteurs drôles et
pathétiques de ses psychodrames, non plus dans un contexte social mais
dans un univers plastique et créateur. Leurs gestes, leurs
préoccupations, intensifiés, semblent dépourvus de sens. Leurs corps –
« véhicules de l’être au monde » pour reprendre les termes de
Merleau-Ponty –, amoindris, décrépis, déformés, puis n’existant que par
fragments témoignent de leur désarroi d’avoir perdu l’évidence de leur
relation au monde.
Tous ces personnages sont représentés
dans des espaces cellulaires indéterminés, crasseux et poussiéreux, sans
fenêtres ; seul le mur, omniprésent, en délimite le cadre tant physique
que mental. Support de signes, de dessins, de graffitis, le mur,
maculé, enregistre les récits, les croyances, les fuites impossibles.
Tout comme les animaux, les objets fatigués – dérisoires ou insolites –
sont élevés au rang de protagonistes surréalistes d’une scène dont ils
brouillent encore plus le sens. Les fils métalliques, électriques,
téléphoniques, suspendus, emmêlés, par leur manifestation récurrente,
envahissante, obsessionnelle, sont comme autant de symptômes de liens
perdus. L’absurde domine l’espace et le structure. Peu de choses sont
laissées au hasard comme l’explique Ballen : « Quant au format carré,
c’est à mes yeux la forme parfaite. Il y a un idéal géométrique dans le
carré. Tous les éléments sont à égalité, ce qui m’est primordial. Chez
moi, ce sont les formes qui comptent, mes photos se jouent dans leurs
correspondances. » Mais rien n’a de sens apparent tout comme l’écriture
de Beckett bouleversant les constructions et fonctions grammaticales
usuelles.
Fruit de plusieurs années de travail, Asylum of the Birds,
dramatique et onirique, est le lieu métaphorique à la fois du refuge et
de l’enfermement. La condition humaine s’y raconte en l’absence de
l’homme. Dans un décor de décharge abandonnée, quelques êtres égarés,
corps morcelés ou privés le plus souvent de leur verticalité, cohabitent
avec une colonie d’animaux. L’oiseau, maître des lieux, libre, assiste à
l’effacement de la vie humaine. L’humanité ne résiste que par sa
trace : figures de son double – poupées, mannequins, masques ; objets
démantelés, rescapés d’une vie antérieure dont ils ne sont plus que la
mémoire ; dessins tracés sur les murs, témoins de l’antique geste de
recréer le monde. Évoquant la série des non-lieux, œuvre ultime de Dubuffet à l’inspiration profondément nihiliste, Asylum
vise à représenter non plus le monde mais l’incorporalité du monde, ce
néant peuplé des fantasmes et fantômes que nous y projetons.
La référence au monde réel disparaît même dans le Théâtre d’apparitions
(2016). Dans les images de ce livre qui occupent un espace entre la
peinture, le dessin, la photographie, la figure humaine est spectrale,
réduite à ses pulsions, ses désirs et ses angoisses.
Au fil des années s’est mis en place le
monde selon Roger Ballen, né de et dans son rapport à la photographie.
Nul doute que la rencontre avec la réalité sociale et psychologique de
l’Afrique du Sud, en particulier de ses « dorps » fut pour lui une
expérience fondatrice : « La découverte de tels lieux signifiait pour
moi que j’aurais à y revenir souvent, attiré là par des raisons
inexplicables. » Si trouble il y a devant ces univers perçus pour leurs
valeurs plastique et esthétique, c’est que, situés en deçà des
événements historiques, ils mettent à nu ce sentiment d’aliénation
ressenti dans un monde où les êtres sont exilés d’eux-mêmes. Mais il
faudra que l’image se libère de son caractère indiciel pour que
l’imaginaire « ballenesque » puisse se réaliser comme métaphore de la
condition humaine. Un imaginaire que l’artiste prolongera dans la vidéo
et l’installation comme théâtralisation de sa vision dystopique du
monde. L’entre-deux, lieu de l’incessant va-et-vient entre animé et
inanimé, réalité et fiction, humanité et animalité, présence et
effacement, nous mène à un espace intérieur aux frontières incertaines.
« Mes images ont de multiples épaisseurs de sens et pour moi il est
impossible de dire qu’une photographie concerne autre chose que
moi-même », aime à rappeler Ballen en écho aux mots de Dubuffet :
« L’homme européen ferait bien de détourner par moments son regard, trop
rivé à son idéal d’homme social policé et raisonnable, et s’attacher à
la sauvegarde extrêmement précieuse à mon sens, de la part de son être
demeurée sauvage. »
JUSQU'AU 31 JUILLET 2020
Halle Saint Pierre
2, rue Ronsard – 75018 Paris
Tél. : 33 (0) 1 42 58 72 89
Du lundi au vendredi de 11h à 18h
samedi de 11h à 19h
dimanche de 12h à 18h
LE SITE DE LA HALLE SAINT PIERRE
LE DOSSIER DE PRESSE
(cliquer)













































.jpg)



































































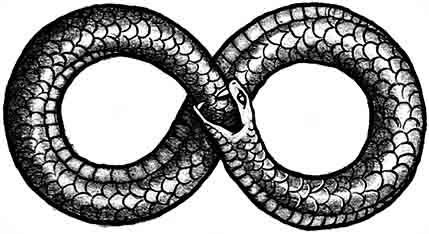





















































Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire